

I.1 Situation de communication
Qui ? à qui ?... Où et quand ? ... Avec quelle intention ? ... on ... nous
I.2 Eléments de base
inductif, déductif, syllogisme, concessif, par l'absurde, par analogie, par élimination
I.5 Les figures de l'éloquence
I.6 Le paragraphe d'argumentation
II.2 Délibérer
III.3 Les genres argumentatifs
I.1.Situation
de communication
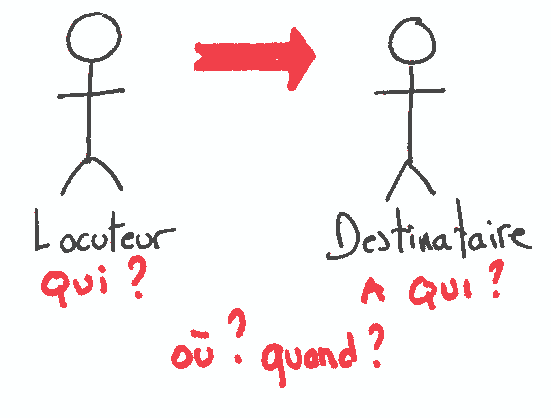
pour revenir au sommaire "argumentation" cliquer le
dessin
La situation de communication repose d’abord sur l’énonciation, c’est-à-dire sur les modalités dans lesquelles l’énoncé est produit. Il convient de déterminer qui ? parle à qui ? où ?, quand ? et dans quelle intention ?
De la précision des réponses apportées à ces différentes questions dépend la réussite de toute argumentation que ce soit dans l’étude du texte proposé ou dans le choix de l’énonciation pour rédiger un devoir.
1.Qui ? à qui ? : le système pronominal et les déterminants
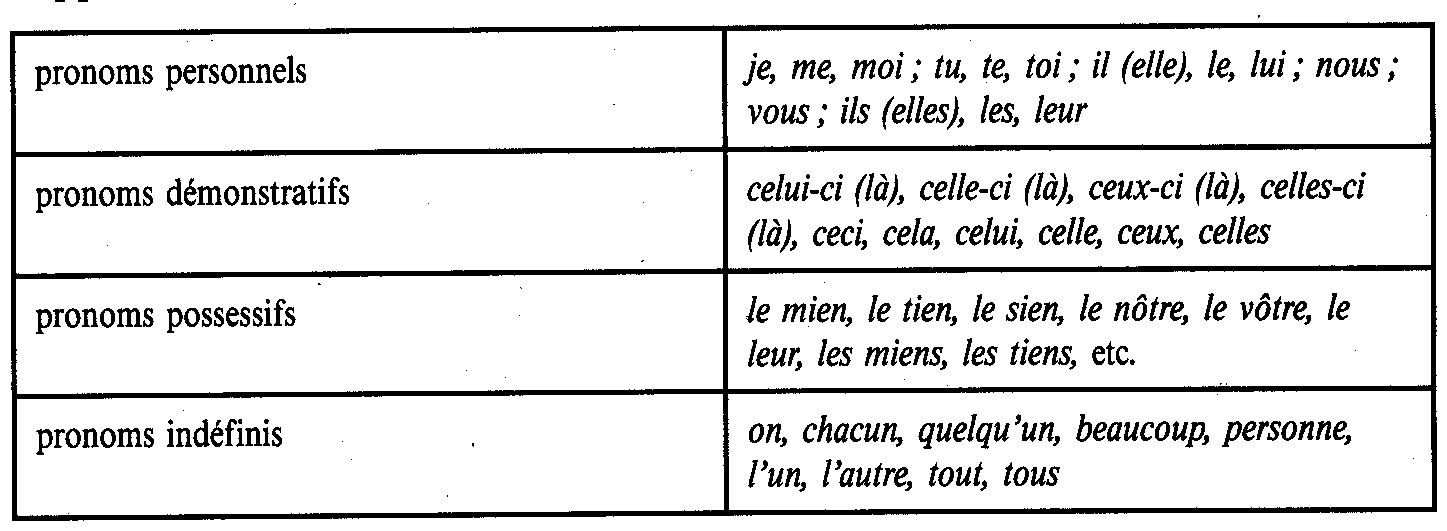
Ce sont en priorité les pronoms personnels qui désignent le locuteur (qui ?) et le destinataire (à qui ?).
Méthode :
Texte 1
Ce récit à la première personne rapporte un témoignage sur la prise de laBastille:
Le 14 juillet, prise de la Bastille. J'assistai, comme spectateur, à cet assaut contre quelques invalides et un timide gouverneur: si l'on eût tenu les portes fermées, jamais le peuple ne fût entré dans la forteresse. Je vis tirer deux ou trois coups de canon, non par les invalides, mais par des gardes françaises, déjà montés sur les tours. De Launay, arraché de sa cachette, après avoir subi mille outrages, est assommé sur les marches de l'Hôtel de Ville; le prévôt des marchands, Flesselles, a la tête cassée d'un coup de pistolet: c'est ce spectacle que des béats sans coeur trouvaient si beau. Au milieu de ces meurtres, on se livrait à des orgies, comme dans les troubles de Rome, sous Othon et Vitellius. On promenait dans des fiacres les vainqueurs de la Bastille, ivrognes heureux, déclarés conquérants au cabaret, des prostituées et des sans-culottes commençaient à régner, et leur faisaient escorte. Les passants se découvraient, avec le respect de la peur, devant ces héros, dont quelques-uns moururent de fatigue au milieu de leur triomphe. Les clefs de la Bastille se multiplièrent, on en envoya à tous les niais d'importance dans les quatre parties du monde. Que de fois j'ai manqué ma fortune! Si moi spectateur, je me fusse inscrit sur le registre des vainqueurs, j'aurais une pension aujourd’hui.
FRANÇQIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND. Mémoires d’outre-tombe
Texte 2
Ce récit est tiré d’une Histoire de' la Révolution française.
Les vieillards qui ont eu le
bonheur et le malheur de voir tout ce qui s'est fait dans ce demi-siècle
unique, où les siècles semblent entassés, déclarent
que tout ce qui suivit de grand, de national, sous la République et l'Empire,
eut cependant un caractère partiel non unanime, que le seul 14 juillet
fut le jour du peuple entier. Qu'il reste donc, ce grand jour, qu'il reste une
des fêtes éternelles du genre humain, non seulement pour avoir
été le premier de la délivrance, mais pour avoir été
le plus haut dans la concorde !
Que se passa-t-il dans cette courte nuit, où personne ne dormit, pour
qu'au matin tout dissentiment, toute incertitude disparaissant avec l'ombre,
ils eussent les mêmes pensées ?
On sait ce qui se fit au Palais-Royal, à l'Hôtel de Ville; mais
ce qui se passa au foyer du peuple, c'est là ce qu'il faudrait savoir.
Là pourtant, on le devine assez par ce qui suivit, là chacun fit
Dans son coeur le jugement demier du passé: chacun, avant de frapper,
le condamna sans retour... L'histoire revint cette nuit-là, une longue
histoire de souffrances, dans l'instinct vengeur du peuple. L'âme des
pères qui, tant de siècles, souffrirent, moururent en silence,
revint dans les fils et parla.
Hommes forts, hommes patients, jusque-là si pacifiques, qui deviez frapper
en ce jour le grand coup de la Providence, la vue de vos familles, sans ressource
autre que vous, n'amollit pas votre coeur. Loin de là, regardant une
fois encore vos enfants endormis, ces enfants dont ce jour allait faire la destinée,
votre pensée grandie embrassa les libres générations qui
sortiraient de leur berceau, et sentit dans cette journée tout le combat
de l'avenir !
Jules Michelet, Histoire de la Révolutîon française
2. Où et quand ? ou les indices spatio-temporels
Toute indication permettant de préciser les circonstances spatiales de l’émission de l’énoncé est évidemment pertinente. Un pays de culture différente peut expliquer une énonciation particulière. On n’argumente pas de la même façon confortablement installé dans un canapé et sous une pluie de bombes!
Le "moment " où l’émetteur produit l’énoncé peut permettre de préciser la situation de communication. Par exemple, l’antériorité d’un événement par rapport au moment de l’énonciation peut permettre de comprendre l’état d’esprit du locuteur.
On s’intéresse enfin aux mots qui révèlent les intentions du locuteur lorsqu’il s’exprime et en particulier à ceux qu’il choisit pour convaincre le destinataire.
Ce sont :
Les modalisateurs : ce sont des mots qui expriment la certitude ou l’incertitude face à une information, un argument. Ils indiquent le degré d’implication du locuteur dans son argumentation.
Exemple : Vous avez peut-être raison ! j’affirme que ce n’est pas vrai.
L’emploi du conditionnel qui exprime le doute, la distance du locuteur à ses propos :
Exemple : Ce serait un phénomène récent.
Examen de quelques pronoms "délicats "
" on "
Pronom indéfini, "on ", dans tous les types de textes, peut remplacer n’importe quelle personne quand le locuteur veut éviter la désignation directe.
Il faut alors se demander
qui " on " désigne et pourquoi le locuteur a-t-il voulu éviter la désignation directe ?
a.qui " on " désigne ?
Le pronom " on " peut avoir :
- une valeur d’indéfini : On frappe à la porte. (=quelqu’un)
- une valeur élargie : On a toujours besoin d’un plus petit que soi. (tout le monde)
(fréquent dans les maximes, sentences, proverbes)
- une valeur de substitut : On vient tout de suite (nous)
On vous épousera, toute fière que l’on est. (elle)
Qu’on se prépare à m’obéir. (ils)
On se tait. (vous)
On se réveille ! (tu)
b.pourquoi le locuteur a-t-il voulu éviter la désignation directe ?
La valeur d’indéfini, la plus " naturelle ", ne pose généralement pas de problème et ne crée pas d’effet particulier sur la situation de communication.
La valeur élargie permet de désigner un groupe sans le nommer par discrétion, par sous-entendu ou par ironie ou simplement pour généraliser et donner une portée " universelle " à un argument ou une situation.
La valeur de substitut permet de désigner une ou plusieurs personnes en particulier (on sait de qui il s’agit) soit par discrétion, par timidité (Bien-sûr qu’on vous aime ! (=je)) soit pour atténuer un ordre en évitant l’impératif, soit pour suggérer, sous-entendre.
L’on est petit à la cour, et quelque vanité que l’on ait, l’on s’y trouve tel ; mais le mal est commun, et les grands même y sont petits. La Bruyère
Allez, vous êtes fou
dans vos transports jaloux,
Et ne méritez pas l’amour qu’on a pour vous. Molière, Le
Misanthrope.
On dit que votre futur est un des plus honnêtes hommes du monde ; qu’il est bien fait, aimable, de bonne mine ; qu’on ne peut avoir plus d’esprit ; qu’on ne saurait être d’un meilleur caractère ; que voulez-vous de plus ? Peut-on se figurer de mariage plus doux, d’union plus délicieuse ? Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard.
Le pronom " nous " désigne le locuteur plus une ou plusieurs autres personnes, pouvant comprendre ou non le (ou les) destinataire(s). Il faut donc éclaircir ce point.
Il peut parfois désigner plusieurs locuteurs (pétition, appel)
Il peut encore désigner le locuteur seul mais parlant au nom d’un groupe (les artistes, les écrivains, les romantiques) ou donnant du volume à sa personne (nous de majesté), ou s’effaçant au contraire dans une pluralité fictive (nous de modestie).
Enfin, il y a le cas du " nous englobant " qui permet au locuteur d’entraîner avec lui le(s) destinataire(s).
Exercice :
Nous vous demandons, M. le Premier Ministre, de trancher sur cette question importante.
Nous allons faire l’exercice trois.
Nous n’allons tout de même pas rester là sans réagir !
Nous remarquons que l’auteur a utilisé le pronom " nous " par modestie.
Nous ne voulons pas vous entendre, nous allons au bain.
Nous ne sommes pas comme les cinéastes, nos images nous les devons créer avec des mots.
![]() retour
au sommaire "ARGUMENTATION"
retour
au sommaire "ARGUMENTATION"
I.2.
Eléments de base
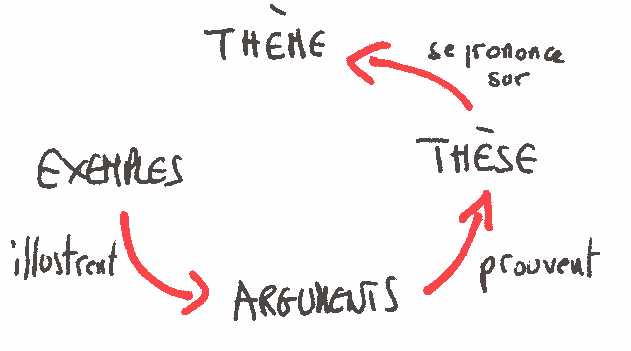
pour
revenir au sommaire "argumentation" cliquer le dessin
Thème/Thèse/Arguments/Exemples
La situation de communication ayant été établie avec précision, on peut se demander à présent quel point de vue on tentera de défendre.
F Toute argumentation traite d’un sujet précis : le thème. Il répond à la question : de quoi parle le sujet ?. La réponse à cette question se présente sous la forme d’un groupe nominal ou d’une proposition infinitive : La justice
L’influence de la télévision sur la violence des jeunes.
Le téléphone portable dans les lieux publics.
Téléphoner avec un portable dans un lieu public.
Le thème ne révèle aucune prise de position, il donne la " matière " de l’argumentation.
F Si le locuteur argumente c’est parce qu’il se prononce sur le thème. Il prend position en exprimant son point de vue sur le thème : c’est la thèse.
La thèse est une proposition déclarative affirmative ou négative (jamais interrogative). Elle doit être contestable (sinon pourquoi argumenter ?).
Elle ne démontre rien, c’est une " affirmation gratuite " qui ne peut se suffire à elle-même.
Elle se caractérise par son haut degré de généralité.
F
Le locuteur doit donc prouver sa thèse, c’est même le principal
objectif de toute argumentation. Pour cela il propose des
arguments. Un argument tente de prouver
la thèse en la justifiant. On peut presque toujours écrire :
Thèse F en effetF Argument
ou encore Argument F doncF Thèse
L’informatique est un précieux outil pédagogique, en effet son caractère souvent ludique motive les élèves.
L’autonomie de chacun face à son ordinateur accélère l’apprentissage donc l’informatique est un précieux outil pédagogique.
L’argument est parfois difficile à distinguer de la thèse car lui aussi peut être contestable.
On peut vérifier la pertinence d'un argument à partir des règles suivantes :
-un argument doit être clairement en rapport avec la thèse et ne doit pas être en contradiction avec un autre argument ;
-l'évocation d'un cas particulier ne peut remplacer un argument, une preuve;
-un énoncé trop général peut ne pas être vrai dans tous les cas. On introduira donc des nuances dans sa formulation ;
Les journalistes recherchent toujours la vérité. (= énoncé trop général)
La mission du journaliste est définie le plus souvent comme la recherche de la vérité des faits. (= énoncé nuancé)
-la validité d'un argument peut être testée par le recours à des connaissances historiques, économiques, littéraires. ..
Les cas historiques d'atteinte à la liberté de la presse sont nombreux; ils confirment l'idée que c'est un domaine sensible.
-Un argument apparaîtra d'autant plus convaincant que sa formulation sera précise. Développer un argument, c'est donner tous les éléments nécessaires à sa compréhension.
Pour convaincre de la valeur d'un livre, on ne se contentera pas de dire qu'il est intéressant, mais on dira en quoi il l'est.
F L’argument reste contestable et théorique, c’est pourquoi il touchera plus facilement le destinataire s'il s'accompagne d’une illustration concrète : l’exemple.
L’exemple n’est pas discutable (on peut en revanche discuter de sa pertinence !) : il présente un fait certain, une statistique, des chiffres...
Exercice:
1. Au néolithique, l'humanité a accompli des pas de géant sans le secours de l'écriture; avec elle, les civilisations historiques de l'Occident ont longtemps stagné. Sans doute concevrait-on mal l'épanouissement scientifique du XIXe et du XXe siècles sans écriture. Mais cette condition nécessaire n'est certainement pas suffisante pour l'expliquer.
Si l'on veut mettre en corrélation l'apparition de l'écriture avec certains traits caractéristiques de la civilisation, il faut chercher dans une autre direction. Le seul phénomène qui l'ait fidèlement accompagnée est la formation des cités et des empires, c'est-à-dire l'intégration dans un système politique d'un nombre considérable d'individus et leur hiérarchisation en castes et en classes. Telle est, en tout cas, l'évolution typique à laquelle on assiste, depuis l'Égypte jusqu'à la Chine, au moment où l'écriture fait son début: elle paraît favoriser l'exploitation des hommes avant leur illumination. Cette exploitation, qui permettait de rassembler des milliers de travailleurs pour les astreindre à des tâches exténuantes, rend mieux compte de la naissance de l'architecture que la relation directe envisagée tout à l'heure. Si mon hypothèse est exacte, il faut admettre que la fonction primaire de la communication écrite est de faciliter l'asservissement. L'emploi de l'écriture à des fins désintéressées, en vue de tirer des satisfactions intellectuelles et esthétiques, est un résultat secondaire, si même il ne se réduit pas le plus souvent à un moyen pour renforcer, justifier ou dissimuler l'autre.
CLAUDE LÉVI-STRAUSS, Tristes tropiques, Éd. Plon, 1955
Quelques cas particuliers intéressants.
F Thèse défendue (soutenue) et thèse réfutée (rejetée).
Afin de prouver sa thèse, le locuteur est souvent amené à envisager les objections de ses contradicteurs. Il confronte alors sa thèse à une autre thèse dont il veut montrer la faiblesse. Pour cela il utilise des contre-arguments.
La thèse rejetée (réfutée) peut être en totale opposition à celle du locuteur ou en opposition partielle (on parlera de concession, voir ci-dessous)
La thèse rejetée peut être implicite ou explicite dans le texte. Si je dis : " il faut limiter le pouvoir du souverain " je m’oppose implicitement à " le souverain doit avoir le pouvoir absolu ".
On désignera la thèse rejetée par différents moyens :
Exercices :
Il faut commencer par se bien dire à soi-même et à se bien convaincre que nous n’avons rien à faire dans ce monde qu’à nous y procurer des sensations et des sentiments agréables.
Les moralistes qui disent aux hommes : réprimez vos passions et maîtrisez vos désirs, si vous voulez être heureux, ne connaissent pas le chemin du bonheur. On n’est heureux que par des goûts et des passions satisfaites.
Mais, me dira-t-on, les passions
ne font-elles pas plus de malheureux que d’heureux ? Je n’ai pas la balance
nécessaire pour peser en général le bien et le mal qu’elles
ont faits aux hommes ; mais il faut remarquer que les malheureux sont connus
parce qu’ils ont besoin des autres, qu’ils aiment à raconter leurs malheurs,
qu’ils y cherchent des remèdes et du soulagement. Les gens heureux ne
cherchent rien et ne vont pas avertir les autres de leur bonheur.
Mme du Châtelet, Discours sur le bonheur, 1779
2. Ce qui est important, ce sont les tendances délinquantes et violentes qui existent en nous et non pas leur expression dans les bandes dessinées, les films ou à la télévision, ni la question de savoir si les mass media alimentent ces tendances et rendent leur contrôle plus difficile.
F L’argument d’autorité : en se référant à une personnalité faisant autorité dans le domaine concerné par sa thèse, le locuteur donne plus de crédibilité à son discours.
F Les types d’exemples :
Dans tous les cas on regardera la position de l’exemple par rapport à l’argument qu’il illustre :
Enfin, il peut arriver qu’un exemple se substitue à un argument : il est alors en général plus développé.
![]() retour
au sommaire "ARGUMENTATION"
retour
au sommaire "ARGUMENTATION"
Les relations logiques peuvent être explicites (indiquées par des connecteurs logiques) ou implicites. Dans ce dernier cas, elles sont sous-entendue par :
L’enjeu électoral était pour lui trop grand : il a vite sombré dans la dépression. (conséquence implicite)
Lorsque la relation doit être explicite (et dans une dissertation c’est souvent préférable) on utilise des connecteurs logiques :
|
Relation logique |
Connecteurs |
Fonction |
|
Addition ou gradation |
Et, de plus, en outre, par ailleurs, surtout, d’abord, ensuite, enfin, d’une part, d’autre part, non seulement, mais encore... |
L’addition permet d’ajouter un argument à un autre, un exemple à un autre La gradation permet l’organisation du moins pertinent au plus pertinent |
|
Parallèle ou comparaison |
De même, de la même manière, ainsi que, comme... |
Permet de rapprocher deux faits, deux raisonnements. |
|
Cause |
Car, en effet, étant donné, parce que, puisque, en raison de, sous prétexte que, dans la mesure où... |
Permet d’exposer l’origine d’une thèse (peut introduire un argument) |
|
Conséquence |
Donc, c’est pourquoi, par suite, de là, d’où, dès lors, de sorte que, si bien que, par conséquent... |
Permet d’introduire un résultat, une thèse par exemple qui découle d’un argument |
|
Concession |
Malgré, même si, en dépit de , bien que, quoique... |
Permet de prendre en compte le point de vue adverse tout en revenant à sa propre thèse ensuite et malgré tout |
|
Opposition |
Mais, au contraire, cependant, pourtant, en revanche, tandis que, alors que, néanmoins, toutefois, or... |
Opposition de deux faits, deux arguments, le plus souvent pour mettre en valeur l’un d’eux. |
![]() retour
au sommaire "ARGUMENTATION"
retour
au sommaire "ARGUMENTATION"
L’argumentation est avant tout une démonstration : elle repose sur un raisonnement logique. L’étude systématique du circuit argumentatif permet de décrire la stratégie, l’organisation des éléments de base dans l’argumentation : le raisonnement du locuteur.
Certains modes de raisonnement " type " méritent une étude particulière.
A partir d’un fait particulier, il aboutit à une conclusion de portée générale.
Le déploiement de forces à Strasbourg en 1997 a transformé un incident de quartier en une véritable guerre civile dans laquelle force de l’ordre et jeunes des quartiers ont tous perdu à s’affronter. Il en est ainsi de toute politique répressive pour traiter la question des banlieues à problème : l’autorité implacable et musclée conduit au contraire de ce qui a motivé sa mise en oeuvre. Il paraît clairement préférable de prévenir par la discussion ces embrasements désastreux plutôt que de les réprimer par plus de violence encore.
Distinguez le fait particulier de la conclusion générale.
A partir d’une hypothèse, d’une idée générale, il permet de déduire une proposition particulière.
Les bouleversements engendrés par la mondialisation sont tels que l’économie locale ne peut plus ignorer les règles du marché international.
Distinguez le fait particulier de la proposition générale.
Consiste, par déduction, à tirer une conclusion de deux propositions vraies (les prémices).
La culture est en crise, tout le monde le reconnaît. Or, l’école transmet la culture. Donc l’école est en crise.
Soulignez de deux couleurs différentes les prémisses et la conclusion. Comment sont-ils articulés ?
Le locuteur feint d’admettre tout ou partie d’un argument de la thèse à laquelle il s’oppose pour finalement revenir à sa thèse et maintenir son point de vue.
Certes, par le passé on pouvait connaître quelques accidents dans ses études mais on finissait plu facilement qu’aujourd’hui par embrasser la carrière qu’on avait choisie.
Repérez la concession et les connecteurs logiques.
Le raisonnement par l’absurde.
Pour réfuter une proposition (argument ou thèse), le locuteur imagine les conséquences absurdes de celle-ci.
Le regroupement des hommes en société serait contre-nature selon Rousseau et expliquerait que l’homme se corrompe et s’avilisse. C’est sans doute par corruption que les poissons au fond des mers se meuvent en bancs ou que les oiseaux migrateurs se rassemblent pour quitter nos contrées trop froides.
Distinguez la thèse adverse de ses conséquences absurdes.
Consiste à transposer une idée dans un autre domaine de réalité afin de la rendre plus claire, plus " parlante ".
On ne peut, lorsqu’on est enseignant, demander à des élèves de travailler davantage, d’être ponctuels, d’aimer ce qu’ils font, d’être motivés sans exiger de soi la même rigueur, le même enthousiasme. A-t-on jamais vu un entraîneur exigent et efficace se lever à midi et conseiller ses sportifs du bord du terrain avachi sur une chaise, le cigare à la bouche ?
Le raisonnement par élimination
Consiste à envisager différentes solutions pour répondre à une question, pour montrer ensuite qu’aucune sauf une y répond vraiment : on donne ainsi l’impression d’avoir envisager toutes les solutions et de ne garder que la meilleure !
A l’individualisme, fléau de notre temps, quels contrepoids proposer ? Tocqueville en distinguait trois : les libertés locales c’est à dire la décentralisation, les associations et la religion. Nous avons progressé depuis en matière de décentralisation et la religion n’a plus suffisamment ce pouvoir fédérateur qu’elle avait alors. Notre effort semble devoir se porter sur les mouvements associatifs qui réclament notre aide et le méritent depuis longtemps.
Identifiez les différentes solutions et entourez celle qui, par élimination, est adoptée par le locuteur.
![]() retour
au sommaire "ARGUMENTATION"
retour
au sommaire "ARGUMENTATION"
Si le discours argumentatif vise à convaincre par des moyens rationnels (une progression fondée sur des relations logiques entre les idées), il cherche aussi souvent à persuader en agissant sur la sensibilité du destinataire par différents procédés rhétoriques et oratoires.
Les figures par analogie (métaphore, comparaison, allégorie, personnification) permettent d'illustrer ou de concrétiser une idée par des images.
Maupassant utilise la métaphore du troupeau pour évoquer la masse des soldats privés de pensée.
Les figures par substitution permettent des raccourcis d'expression (métonymie, synecdoque) ou l'introduction d'une définition (périphrase).
Danton, par une métonymie, fait du tocsin la charge sur les ennemis de la patrie comme pour en accélérer le mouvement.
Les figures par opposition soulignent des contradictions (antithèse, chiasme), parfois de manière ironique (antiphrase) ou dans le but de surprendre (paradoxe, oxymore).
Maupassant recourt à l'antiphrase du massacreur de génie pour désigner ironiquement M. de Moltke.
Les figures par amplification (hyperbole, anaphore, gradation) donnent plus d'ampleur, d'emphase à une idée; les figures par atténuation (euphémisme, litote) au contraire visent à suggérer plus qu'à affirmer directement.
Maupassant amplifie l'horreur de la guerre par l'hyperbole des lacs de sang et des plaines de chair pilée.
Zola atténue l'idée de la mort par l'euphémisme du bon sommeil.
Les procédés liés à l'énonciation permettent d'impliquer le destinataire, d'affirmer ou de nuancer un point de vue.
L'apostrophe consiste à s'adresser directement à une personne présente ou absente.
Les modes du verbe peuvent donner au discours un caractère injonctif (impératif, subjonctif) ou introduire des nuances (conditionnel).
L'interrogation rhétorique (ou oratoire) permet de s'adresser à l'interlocuteur par une question sans attendre de réponse, celle-ci étant donnée ou suggérée par l'interrogation. C'est une manière déguisée d'affirmer une opinion.
L'exclamation ou les points de suspension permettent de communiquer une émotion (indignation, surprise...) ou d'établir une complicité avec le destinataire en jouant sur des sous-entendus (implicite).
La structure et le rythme de la phrase sont essentiels pour soutenir le propos de celui qui argumente.
Dans des phrases courtes et percutantes, la pensée s'exprime sous forme de maximes ou d'aphorismes.
Elle se développe de manière ample et harmonieuse dans les périodes (phrases complexes aux rythmes binaire ou ternaire, comportant des phases ascendante et descendante).
![]() retour
au sommaire "ARGUMENTATION"
retour
au sommaire "ARGUMENTATION"
Selon les cas, le paragraphe d’argumentation peut prendre différentes formes. Cependant, il vérifie généralement les caractéristiques suivantes :
Exemple :
Nos sociétés modernes se distinguent par une recherche effrénée de l’accomplissement personnel, de la réussite individuelle (thèse). Cette recherche de la réussite individuelle semble imposée par la société qui pousse à la concurrence et à la compétition et consacre la réussite au dépend des autres (argument). Il faut être premier à l’école, au travail, dans sa vie sentimentale.(exemples)
Autre signe de cet individualisme forcené et presque inconscient (rappel de la thèse), chacun a de plus en plus tendance à se retirer dans la forteresse de la sphère privée en même temps que l’intérêt pour la vie collective diminue(argument). Il suffit de regarder l’abstention croissante aux élections et ce même aux municipales, niveau collectif de proximité pourtant. Le nombre de citadins qui ne connaissent même pas leur voisin de pallier signale également, de façon criante, ce " cocooning " exclusif qui ne cesse de s’accentuer (exemples).
On peut, Bien-sûr, à partir de ce " standard ", varier les moyens :
Guy de Maupassant
Le Fantastique
Extrait d'un article publié en 1883.
Lentement, depuis vingt ans,
le surnaturel est sorti de nos âmes. Il s'est évaporé comme
s'évapore un parfum quand la bouteille est débouchée. En
portant l'orifice aux narines et en aspirant longtemps, longtemps, on retrouve
à peine une vague senteur. C'est fini. Nos petits-enfants s'étonneront
des croyances naïves de leurs pères à des choses si ridicules
et si invraisemblables. Ils ne sauront jamais ce qu'était autrefois,
la nuit, la peur du mystérieux, la peur du surnaturel. C'est à
peine si quelques centaines d'hommes s'acharnent encore à croire aux
visites des esprits, aux influences de certains êtres ou de certaines
choses, au somnambulisme lucide, à tout le charlatanisme des spirites.
C'est fini.
Notre pauvre esprit inquiet, impuissant, borné, effaré par tout
effet dont il ne saisissait pas la cause, épouvanté par le spectacle
incessant et incompréhensible du monde a tremblé pendant des siècles
sous des croyances étranges et enfantines qui lui servaient à
expliquer l'inconnu. Aujourd'hui, il devine qu'il s'est trompé, et il
cherche à comprendre, sans savoir encore. Le premier pas, le grand pas
est fait. Nous avons rejeté le mystérieux qui n'est plus pour
nous inexploré.
Dans vingt ans, la peur de l'irréel n'existera plus même dans le
peuple des champs. Il semble que la Création ait pris un autre aspect,
une autre figure, une autre signification qu'autrefois. De là va certainement
résulter la fin de la littérature fantastique.
Elle a eu, cette littérature, des périodes et des allures bien
diverses, depuis le roman de chevalerie, les Mille et Une Nuits, les
poèmes héroïques, jusqu'aux contes de fées et aux
troublantes histoires d'Hoffmann et d'Edgar Poe. Quand l'homme croyait sans
hésitation, les écrivains fantastiques ne prenaient point de précautions
pour dérouler leurs surprenantes histoires. Ils entraient, du premier
coup, dans l'impossible, et y demeuraient, variant à l'infini les combinaisons
invraisemblables, les apparitions, toutes les ruses effrayantes pour enfanter
l'épouvante.
Mais, quand le doute eut pénétré enfin dans les esprits,
l'art est devenu plus subtil. L'écrivain a cherché les nuances,
a rôdé autour du surnaturel plutôt que d'y pénétrer.
Il a trouvé des effets terribles en demeurant sur la limite du possible,
en jetant les âmes dans l'hésitation, dans l'effarement. Le lecteur
indécis ne savait plus, perdait pied comme en une eau dont le fond manque
à tout instant, se raccrochait brusquement au réel pour s'enfoncer
encore tout aussitôt, et se débattre de nouveau dans une confusion
pénible et enfiévrante comme un cauchemar.
L'extraordinaire puissance terrifiante d'Hoffmann et d'Edgar Poe vient de cette
habileté savante, de cette façon particulière de coudoyer
le fantastique et de troubler, avec des faits naturels où reste pourtant
quelque chose d'inexpliqué et de presque impossible.
Le Gaulois, 7 octobre 1883.
![]() retour
au sommaire "ARGUMENTATION"
retour
au sommaire "ARGUMENTATION"
On distingue une argumentation qui vise à convaincre d'une argumentation qui utilise la persuasion en fonction des moyens mis en oeuvre par le locuteur.
Si celui-ci a recours à la raison et se contente de produire une thèse et des arguments illustrés d'exemples, le tout structuré par des relations logiques, on dira qu'il cherche à convaincre.
Si il utilise des procédés oratoires et rhétoriques pour toucher la sensibilité du destinataire, on dira qu'il cherche à persuader.
Exemples de persuasion.
Pourquoi se mentir? Croyez-moi, vous ne gagnerez rien à répéter inlassablement des idées toutes faites qu'on vous inocule malgré vous au fil d'émissions formatées et conformistes. Réveillez-vous! jeunes de France, jeunes d'Europe, jeunes du monde! L'avenir est à ceux qui changeront le présent. Quittez le troupeau des faux rebelles, prenez ces chemins de traverses que la broussaille encombre, ces chemins buissonniers de l'opinion personnelle, libres et intactes que seuls vous, jeunes esprits, pourrez peut-être défricher encore... Le bruit des médias prolifère pour bientôt prendre toute la place dans vos vies infertiles. Le beau mensonge tue votre imaginaire et le remplace.
Les
couleurs ci-dessous renvoient aux exemples correspondants dans l'exemple.
Les procédés rhétoriques
Les
figures par analogie
(métaphore, comparaison, allégorie, personnification).
Les figures par substitution (métonymie,
synecdoque, périphrase).
Les figures par opposition (antithèse,
chiasme, antiphrase,paradoxe, oxymore).
Les figures par amplification (hyperbole,
anaphore, gradation); les figures par atténuation (euphémisme,
litote).
Les procédés
oratoires
Les procédés liés à l'énonciation
permettent d'impliquer le destinataire, d'affirmer ou de nuancer un point de
vue.
L'apostrophe consiste à s'adresser
directement à une personne présente ou absente.
Les modes du verbe peuvent donner au discours un caractère injonctif
(impératif, subjonctif) ou introduire des nuances (conditionnel).
L'interrogation rhétorique (ou oratoire)
permet de s'adresser à l'interlocuteur par une question sans attendre
de réponse, celle-ci étant donnée ou suggérée
par l'interrogation. C'est une manière déguisée d'affirmer
une opinion.
L'exclamation ou les
points de suspension permettent de communiquer une émotion
(indignation, surprise...) ou d'établir une complicité avec le
destinataire en jouant sur des sous-entendus (implicite).
La structure et le rythme de la phrase sont essentiels pour soutenir le propos
de celui qui argumente.
II.2. Délibérer
Un texte est dit délibératif lorsqu'il confronte différentes opinions avant d'en faire émerger une résultant de cette confrontation. Ces opinions peuvent être discutées avec d'autres ou en soi-même par le locuteur. La réflexion qui conduit à une décision, le débat public, la discussion supposent cette délibération. L'essai, le dialogue, l'apologue ou l'échange épistolaire sont le plus souvent délibératifs.
Pour montrer le caractère délibératif d'un texte, on cherchera:
- les thèses en présence
- la conclusion de l'auteur
- l'expression de l'alternative, de l'hésitation
- le raisonnement concessif
- le jeu des pronoms
- les évaluatifs
![]() retour
au sommaire "ARGUMENTATION"
retour
au sommaire "ARGUMENTATION"
II.3. Les genres argumentatifs
On distingue:
L'ESSAI
Généralement, l'essai est délibératif:
il confronte une opinion personnelle (celle de l'essayiste) à d'autres
thèses desquelles il s'inspire en les nuançant ou en les réfutant.
On cherchera donc à montrer cette
confrontation, à faire apparaître les différentes
thèses en présence ainsi que les moyens mis en oeuvre pour
les réfuter ou les nuancer.
L'auteur peut aussi accepter en partie une thèse: c'est la concession.
On montrera également l'engagement personnel plus
ou moins fort de l'auteur dans son argumentation par l'étude des pronoms,
des évaluatifs ou des modalisateurs.
L'APOLOGUE
C'est un récit généralement
court et plaisant en prose ou en vers qui a une visée
argumentative explicite ou implicite.
Etudier un apologue c'est donc toujours faire la part du narratif et de l'argumentatif.
La part du narratif: montrer les atouts du récit au service de l'argumentation: le schéma narratif, la temporalité, les personnages, les lieux, la dramatisation, le merveilleux, les registres comique, ironique, parodique, satirique...
La part de l'argumentatif: montrer la ou les thèse(s) présente(s), montrer comment l'auteur est présent ou non dans le récit, quel parti prend-il?, qui est la cible?, le rôle des dialogues...
Ces deux axes d'étude peuvent constituer un plan d'étude pour bien des apologues.
Les formes de l'apologue sont:
- la fable (lorsqu'elle est en vers, on
ajoutera aux outils précédents l'étude de la versification)
- le conte philosophique
- la parabole
- l'utopie (on ajoutera aux recherches l'expression
de l'idéalisation: voc. mélioratif, laudatif, tournures superlatives...)
LE DIALOGUE
Le dialogue est la forme idéale de la délibération car
il permet la dramatisation de la confrontation d'idées par la présence
d'interlocuteurs. Le débat politique
prend parfois la forme du dialogue. Le dialogue est présent dans bien
d'autres genres:
- au théâtre: il permet l'échange entre les personnages et n'est pas toujours argumentatif. Lorqu'il l'est, on doit prendre en compte la complexité de l'énonciation dramatique afin de situer le dramaturge par rapport aux thèses échangées. Certains monologues peuvent prendre la forme d'un dialogue intérieur qui trahit l'état de trouble, d'indécision... d'un personnage. La didascalie peut préciser les intentions, les émotions, la sincérité... des interlocuteurs
- dans les romans ou les nouvelles: il permet, lorsque les propos sont rapportés au discours direct, de faire entendre les voix des protagonistes sans la distanciation du récit.
- le dialogue philosophique: hérité de Platon (V° av. J.C.) et des philosophes grecs, il suppose une méthode d'"accouchement de la vérité" (la maïeutique): le locuteur principal, par ses questions, ses objections... fait progressivement naître chez son interlocuteur la vérité. Très utilisé par les philosophes des Lumières, il est souvent un prétexte à l'affirmation des thèses du philosophe (les interlocuteurs ne sont pas à égalité dans la confrontation et c'est finalement le lecteur qui "accouche" d'une vérité plus ou moins explicitement amenée par le philosophe).
Ce qu'on doit chercher dans un dialogue:
- l'époque, les personnages
- le thème, les thèses en présence
- les valeurs en question
- le rôle des verbes introducteurs
- les registres satirique, ironique, polémique
- les écarts d'éloquence entre les interlocuteurs
- la thèse issue de la délibération (qui l'a emporté,
pourquoi?...)